« C’est un chemin pour apprendre à se connaître en profondeur. »
NOS EXPERTISES
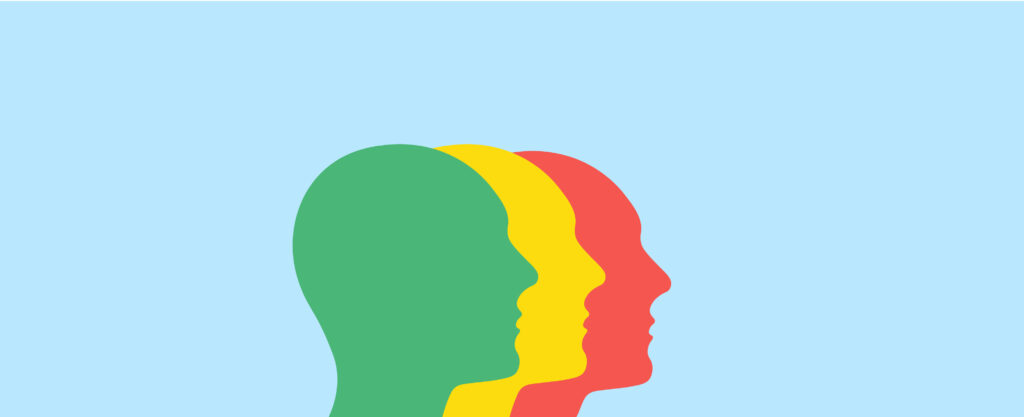
ENNÉAGRAMME
QU’EST-CE QUE L’ENNÉAGRAMME ?
L’ennéagramme est une méthode de connaissance de soi qui propose une typologie de personnalités en neuf bases, comme autant de manières différentes de se comprendre, de ressentir le monde et de s’y investir.
L’ennéagramme donne des pistes au quotidien pour mieux se connaître et s’accepter, et recevoir les autres tels qu’ils sont, dans leur différence. Il nous amène également à découvrir des voies de progression, pour ne pas rester enfermé dans des impasses, mais au contraire, trouver le chemin pour épanouir nos talents.
ETYMOLOGIE
Le mot « ennéagramme » vient du grec « ennea » (9) et « gramma » (figure) qui désigne une figure à 9 points. L’ennéagramme est un système d’étude de la personnalité fondé sur une typologie en 9 profils. Il est représenté par un diagramme en forme de cercle avec neuf points portant neuf numéros. L’ennéagramme prend en compte davantage les motivations qui nous poussent à agir que nos comportements.
MISE EN LUMIÈRE DE NOS POINTS FORTS ET DE NOS LIMITES
Chaque point de l’ennéagramme représente une force, une énergie, tendue vers un but, une valeur. Dès la petite enfance, l’expression de ce don est confrontée aux limites de l’environnement et nous développons une stratégie afin de nous adapter. Comme cette stratégie est sécurisante, nous la répétons et devenons des « experts » dans cette manière de faire. Ce comportement récurrent marque notre personnalité, mais cette protection, familière et habituelle, nous bloque dans le développement de nos autres potentialités.
POUR QUOI SE FORMER À L’ENNÉAGRAMME ?
Mieux se connaître : l’ennéagramme permet de nommer ce qui fait notre force. Il permet aussi de pointer ce qui nous limite, ce
comportement automatique et quasi-systématique qui nous empêche d’explorer d’autres horizons.
Évoluer : la conscience de notre propre fonctionnement permettra notre propre évolution ; pas à pas, nous pourrons nous ouvrir aux autres facettes de notre personnalité et laisser notre talent s’épanouir pleinement.
Mieux comprendre les autres : outre la meilleure perception de notre propre fonctionnement, l’ennéagramme nous permet une meilleure compréhension des autres. Nous pouvons ainsi comprendre des personnes qui nous sont proches, dans notre vie personnelle ou
professionnelle, et décrypter plus facilement certains comportements qui nous semblent étranges, voire heurtant.
HISTORIQUE
AVERTISSEMENT
Ce qui s’écrit sur l’ennéagramme avant le vingtième siècle est très hypothétique : personne ne connaît véritablement les origines de l’ennéagramme et plusieurs sources sont évoquées. On ne peut pas non plus repérer les chemins d’une transmission historique de l’ennéagramme, et d’autant moins que, vraisemblablement, la transmission aurait été principalement orale.
Pour autant, il est certain que des philosophes et des « sages » ont vécu autour du bassin méditerranéen dans l’antiquité et qu’ils ont développé des moyens de mieux se connaître, des approches didactiques et symboliques, et des pratiques vertueuses ou ascétiques parmi lesquelles on peut voir des correspondances avec ce que nous nommons aujourd’hui ennéagramme. Il est raisonnable de penser que ces philosophes ou ces sages aient pu influencer des mystiques chez qui on repère ces correspondances : des chrétiens (moines et pères du désert), puis des musulmans (l’ennéagramme semble encore transmis par certains soufis, branche mystique de l’islam).
Tout ceci constitue des enjeux de recherche intéressants pour des historiens, mais n’apporte pas, en l’état actuel des connaissances, d’éléments d’authentification et de crédibilité pour l’ennéagramme en tant que méthode, et encore moins en tant que démarche « spirituelle ».
Au contraire, rechercher cette « origine » et cette « filiation » (hypothétiques) nous semble confusant et peu déontologique.
AU 20ÈME SIÈCLE
A. La question de Gurdjieff
Plusieurs auteurs font de George Ivanovitch Gurdjieff (1872(?) – 1949), l’inventeur ou le transmetteur de l’ennéagramme en occident au début du vingtième siècle. Né sur les bords de la Mer Noire, G. Gurdjieff est confronté à différentes religions et cultures. Il rêve d’associer la sagesse de l’Orient à celle de l’Occident et développe un enseignement ésotérique intégrant la figure en neuf points de l’ennéagramme.
Arrivé en France en 1922, il fonde à Avon, près de Fontainebleau, l’Institut de développement holistique de l’homme.
B. Oscar Ichazo et sa “descendance”
Né en 1931, ce fils de haut fonctionnaire bolivien a été initié très tôt à l’ennéagramme au cours de ses voyages au Moyen-Orient. Professeur en psychologie, il enseigne à l’Institut de psychologie appliquée de Santiago du Chili. Il retrouve la correspondance entre les neuf bases et les neuf passions.
En 1970, il organise un stage de onze mois à Arica (à la frontière entre le Chili et le Pérou) où viennent se former une cinquantaine de chercheurs du monde entier, dont Claudio Naranjo.
• Claudio Naranjo
Médecin chilien, Claudio crée et anime des équipes de recherche autour de l’ennéagramme. Il initie le travail en panels de personnes de la même base. Deux participants des groupes de Naranjo vont jouer un rôle important dans la transmission de l’ennéagramme : Bob Ochs et Helen Palmer.
• Bob Ochs
Père jésuite, il participe, dès 1971, au groupe de travail de Naranjo à San Francisco. Il est particulièrement intéressé par des liens qui lui
semblent évidents entre « les idées du centre mental supérieur » des points 3, 6 et 9 du triangle et les vertus théologales : la Foi, l’Espérance et la Charité ; ainsi que par le sens des flèches qu’il interprète en rapport avec les mouvements de consolation et de désolation décrits par Ignace de Loyola dans Les Exercices. Il enseigne l’ennéagramme à l’Université Loyola de Chicago. A partir de l’enseignement de Bob Ochs, l’ennéagramme se développe dans
les milieux chrétiens.
• Helen Palmer
Docteur en psychologie, elle réside à San Francisco et participe depuis 1974 aux équipes de recherche de Claudio Naranjo, après avoir travaillé sur les 9 styles d’intuition.
Elle développe le système des panels qui avait été mis au point par Naranjo. Et elle monte avec David Daniels une formation de formateurs à l’Université de Stanford.
C. Les premières publications
• Premier livre en 1984
Trois étudiants de Bob Ochs : le père O’Leary, Maria Beesing et Robert Nogosek publient en 1984 le premier livre sur l’ennéagramme, au départ banni de la tradition orale. C’est ainsi que l’ennéagramme est passé dans le domaine public.
Le livre est traduit en français en 1992 : « L’ennéagramme, un itinéraire de la vie intérieure» (Editions DDB).
• Première conférence internationale de l’ennéagramme à Stanford en 1994
Elle réunit les différentes écoles et aboutit à la création de l’Association Internationale de l’Ennéagramme (IEA).
DÉONTOLOGIE
ENNÉAGRAMME : QUELS DISCERNEMENTS ?
L’ennéagramme est à la mode : les livres abondent, les sessions se multiplient, un nombre croissant de personnes s’intéressent à cette démarche de connaissance de soi et de développement personnel… Pourtant des maladresses d’emploi ou des contre-indications de la démarche peuvent inquiéter à juste titre. Elles doivent être analysées avec les critères usuels de discernement des méthodes pédagogiques et des pratiques de développement personnel, sans oublier de situer la philosophie de l’homme (“anthropologie”) sous-jacente.
L’ennéagramme échappe d’autant moins aux questions posées par l’usage des méthodes psychologiques ou thérapeutiques qu’il s’inscrit, pour certains, dans une démarche de type New Age voire, dans quelques cas, résolument ésotériques, dans une vision réductrice de la personne et de sa liberté.
En outre, l’usage de l’ennéagramme par des groupes sectaires contribue à jeter un discrédit sur cette méthode. (C’est dans ce contexte que l‘UNADFI (Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l’Individu Victimes de Sectes) met en garde contre l’usage de l’ennéagramme.)
UNE QUESTION ACTUELLE
Dès sa création, l’IEDH a inscrit l’ennéagramme parmi les méthodes de connaissance de soi et de développement personnel nécessaires aux formateurs et susceptibles d’être proposées dans des stages, notamment pour les particuliers. En effet, la finesse d’investigation qu’il permet, la prise en compte des différents plans de la personnalité et la puissance de la transformation qu’il induit font de l’ennéagramme une démarche efficace et féconde.
L’impact de l’ennéagramme suscite des questions et des inquiétudes qui rejoignent les critiques, bien connues, suscitées par l’usage des méthodes de développement personnel en général. C’est pourquoi, dès 2001, l’IEDH a formalisé sa déontologie et ses critères de discernement, publiés sous la forme de 10 points de repères (ci-dessous).
NOS POINTS DE REPÈRES :
1. Si l’origine de l’ennéagramme comme figure symbolique et mnémotechnique semble se perdre dans la nuit des temps, (voir
historique), la méthode proposée aujourd’hui sous ce nom à travers des livres et des formations a été développée au milieu du XXème siècle. Elle est clairement attribuable à des auteurs comme Oscar Ichazo, Claudio Naranjo, Helen Palmer, Bob Ochs,… et leurs successeurs.
2. En tant que méthode globale, l’ennéagramme est analysable et évaluable sur sa pertinence et son efficacité tant au plan conceptuel que pratique (mais les évaluations en langue française sont encore trop peu nombreuses[1]).
3. En tant que guide de description et de connaissance de soi, et sans les ajouts philosophiques ou spirituels que certains lui apportent, il est compatible avec une anthropologie chrétienne[2].
4. En particulier, en situant la “blessure” par rapport à un “don”, il est à la fois :
• outil de thérapeutique (travail de mémoire sur un passé, permettant de lever des méconnaissances),
• aide à une dynamique de développement (ouverture sur une perspective de changement, découvrant des portes).
5. Pour autant, l’ennéagramme, qui permet diagnostic et balisage, ne contient pas, en lui-même, les outils de développement personnel nécessaires au cheminement ultérieur.
6. En outre sa découverte nécessite un accompagnement par un formateur sérieux, en groupe ou individuellement. (Se borner à la lecture d’un livre quel qu’il soit est, au mieux, insuffisant, au pire, dangereux).
7. La puissance d’investigation de l’ennéagramme et les objets mêmes (“compulsion”) du travail qu’il permet, font que cette méthode présente des risques pour des personnalités encore trop peu structurées ou psychiquement fragiles ; nous recommandons un âge minimal d’accès, non à la connaissance conceptuelle de l’approche, mais à son emploi dans un cadre institutionnel. Un entretien préalable permet de situer la demande et de valider l’indication.
8. Cette puissance peut entraîner une fascination excessive. Aussi est-il préférable de proposer au partenaire peu familiarisé avec l’introspection une première découverte de soi à partir d’outils plus simples et plus classiques (caractérologie, bases de l’Analyse Transactionnelles, assertivité, éléments de PNL,…) et, si possible, en s’appuyant sur une approche anthropologique solide.
9. La progressivité de la découverte impose qu’on respecte le rythme du participant et, en particulier, qu’on ne lui annonce jamais sa base présumée, ce qui a pour corollaire :
• qu’on ne corrige pas la base qu’il déclare, même si cela semble une erreur ou une illusion (à lui d’en faire la découverte) ;
• qu’on s’abstient d’utiliser les numéros des bases dans la conversation courante, hors séance de travail ;
• qu’on ne type pas à distance (des personnes dans un groupe, des personnes connues mais absentes,…)
10.Enfin, toutes les précautions usuelles quant à la déontologie du formateur sont évidemment de rigueur : liberté de choix, respect de la liberté de la personne, discrétion, distance juste, professionnalisme, supervision du formateur, …
En résumé : l’ennéagramme est, pour nous, une méthode contemporaine, parmi d’autres, à utiliser avec doigté et discernement !
RÉFÉRENCES
[1] Depuis 2001, des travaux intéressants ont été publiés :
– Halin et Prémont en Belgique, pour la validation scientifique de l’ennéagramme.
[2] Voir par exemple les travaux du groupe Ennéacath.
TÉMOIGNAGES DE PARTICIPANTS
« Cela m’a permis de devenir plus tolérant et plus humain. »
Marc
« Ce stage m’a confortée dans l’idée que l’on peut changer, sortir de ses automatismes. »
Brigitte
« C’est un outil très positif et ouvert, je me suis sentie libérée ! »
Sabine
« C’est une présentation constructive pour prendre conscience de soi-même sans se décourager ni s’enfermer. »
Olivier
Inscrivez-vous pour recevoir notre newsletter
avec les informations sur nos formations
